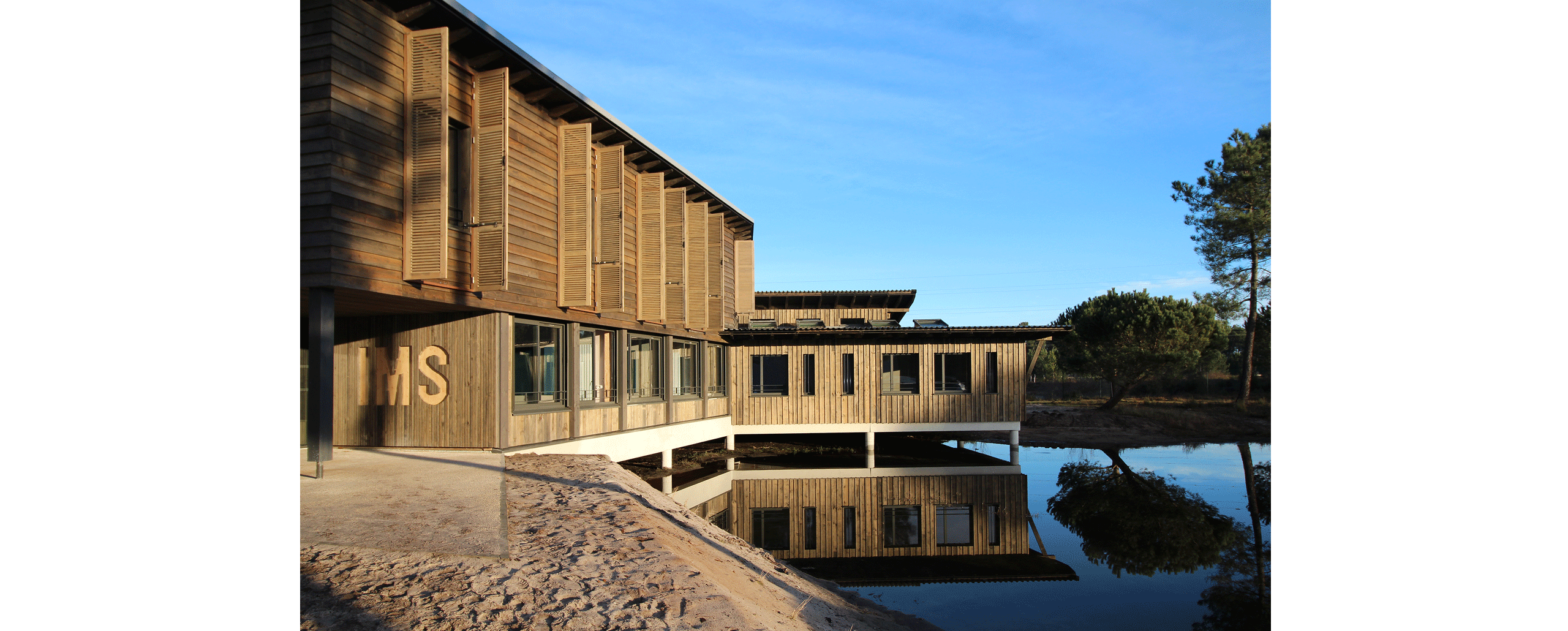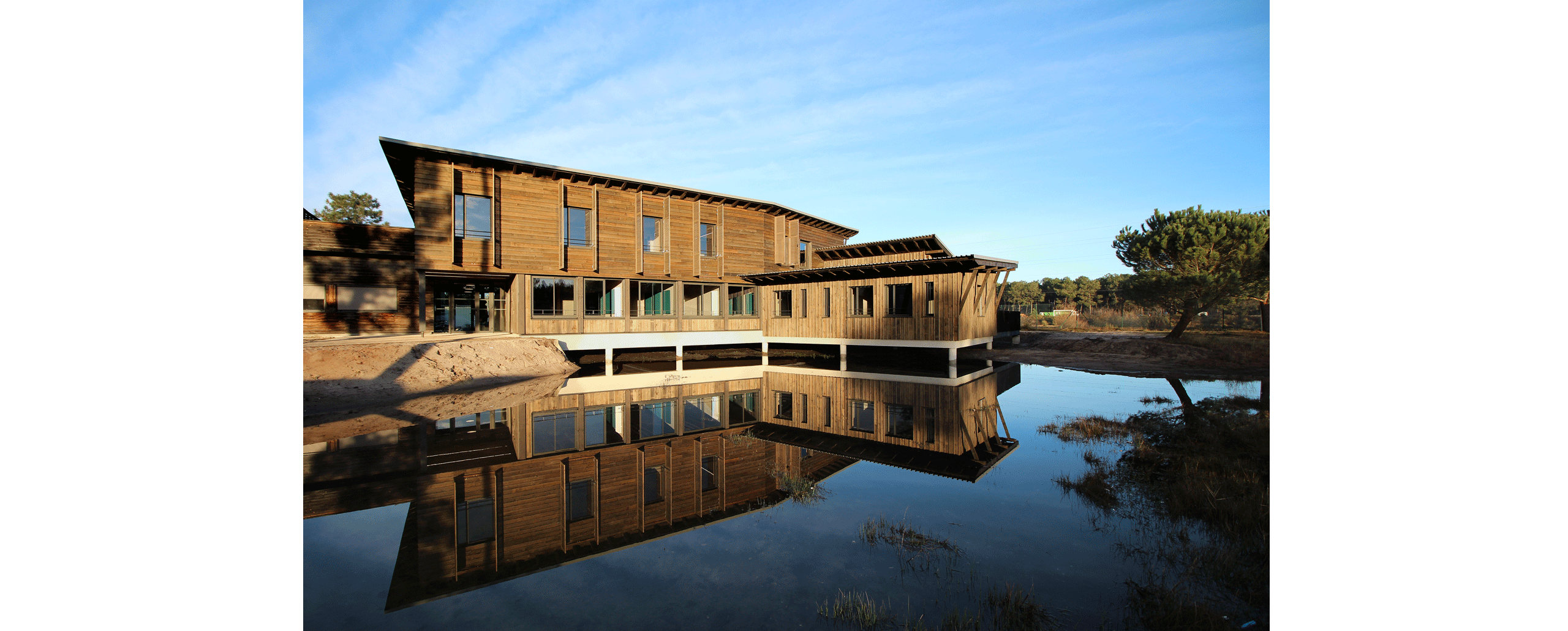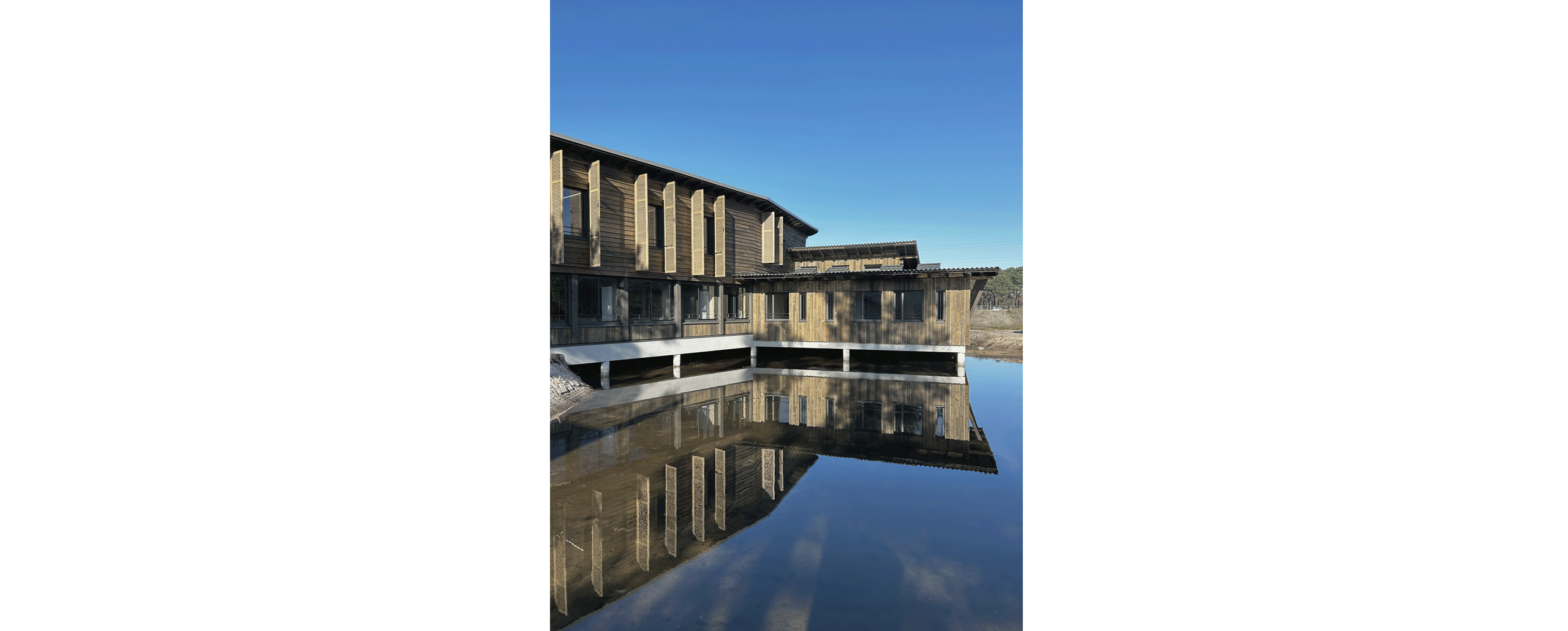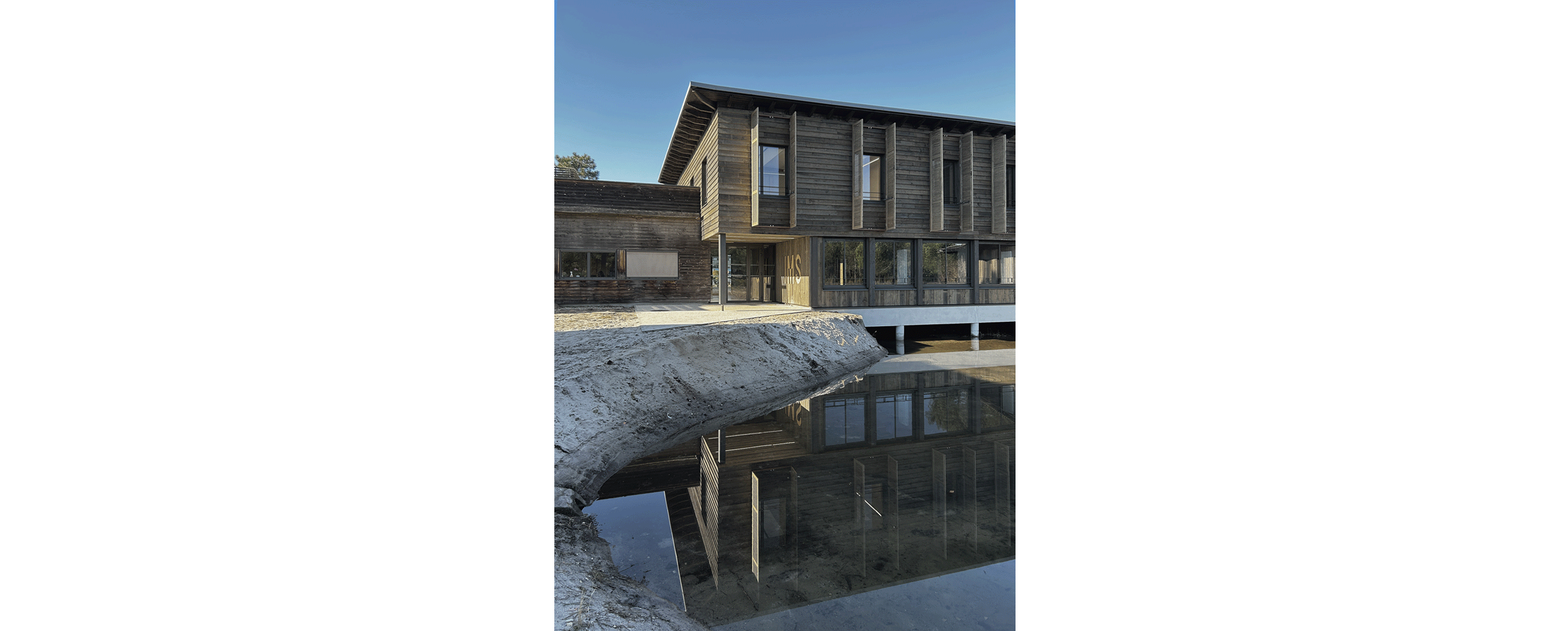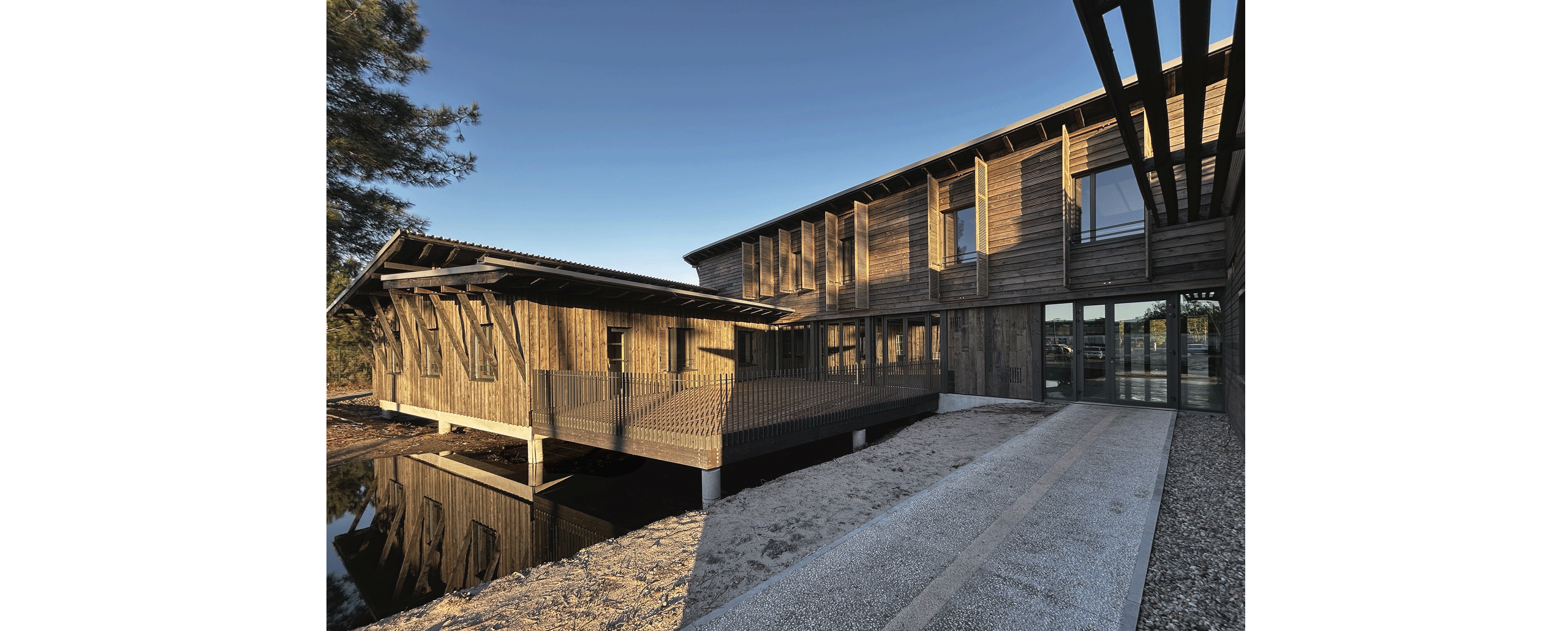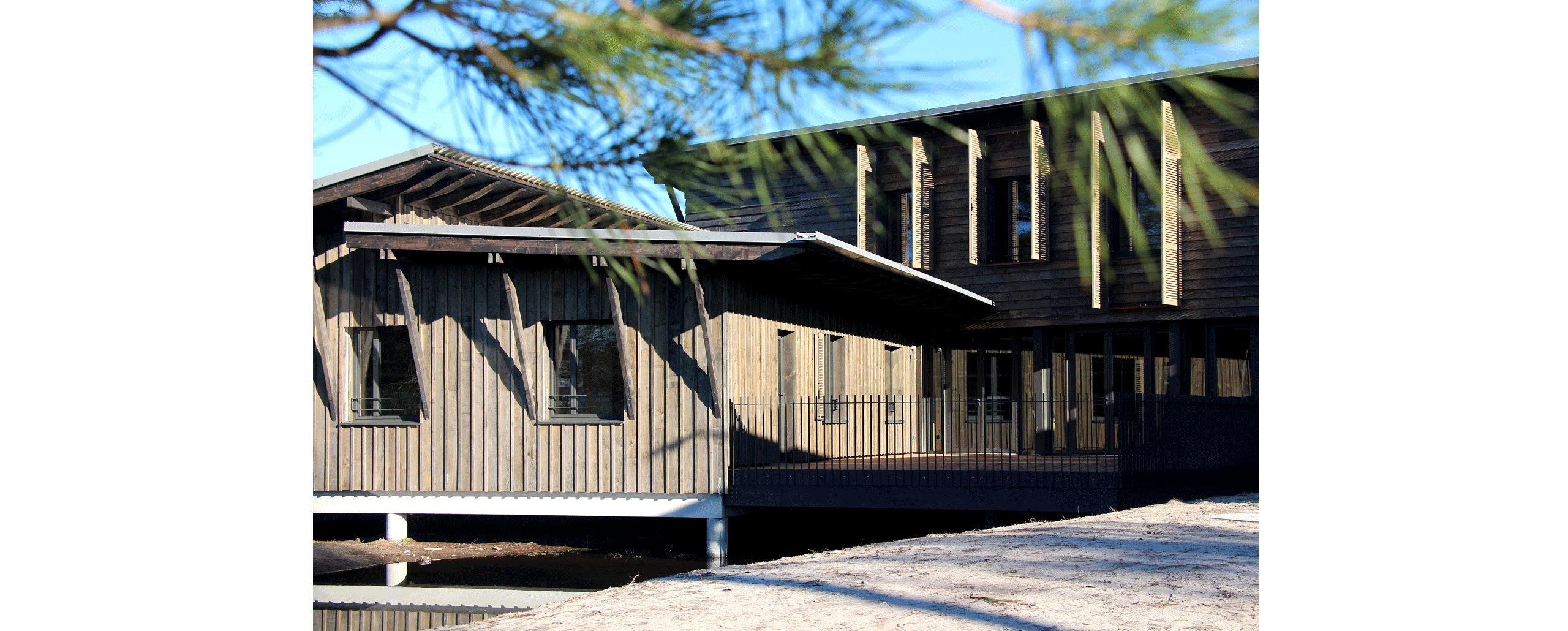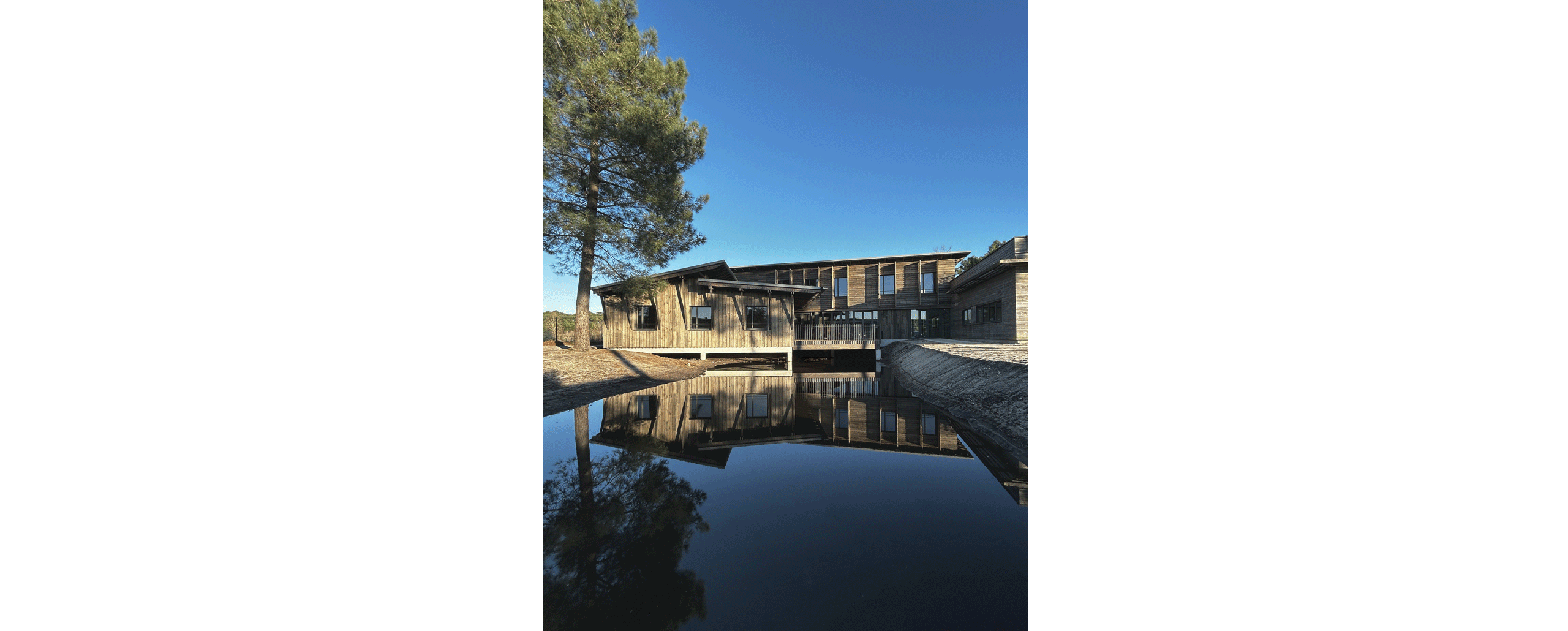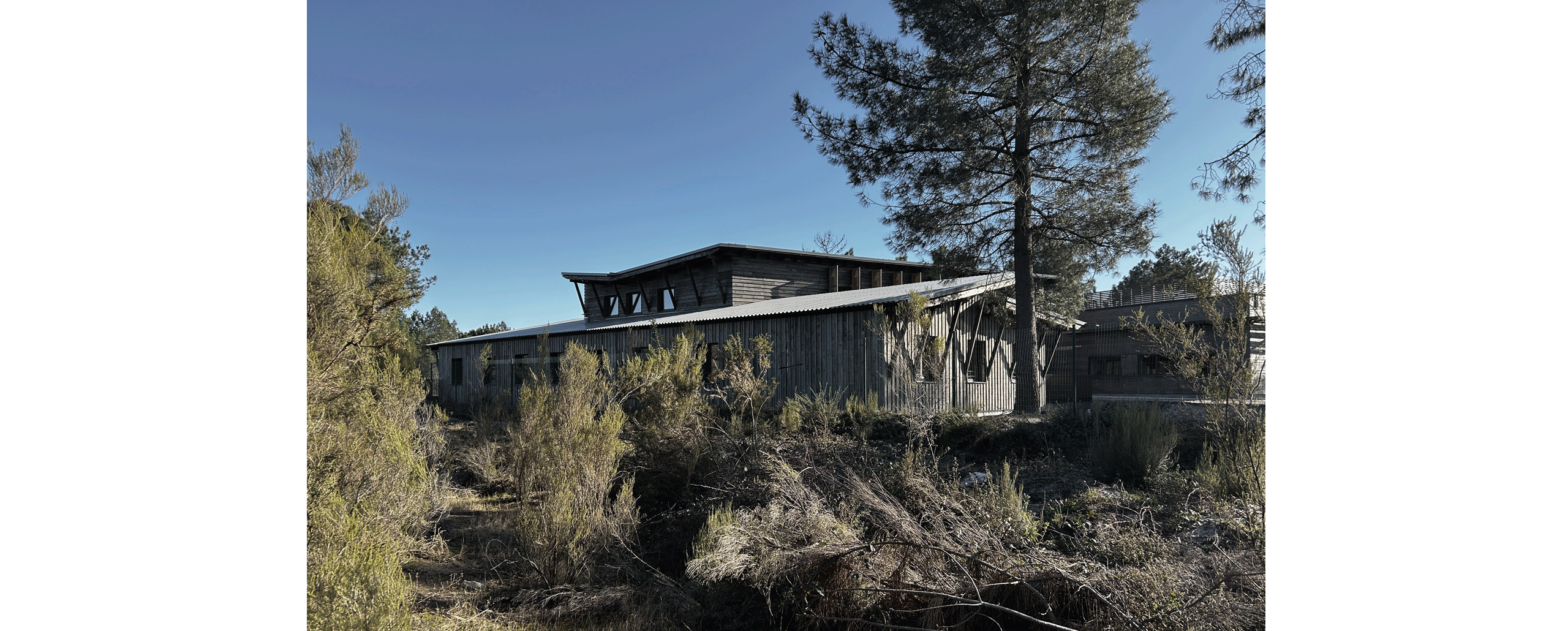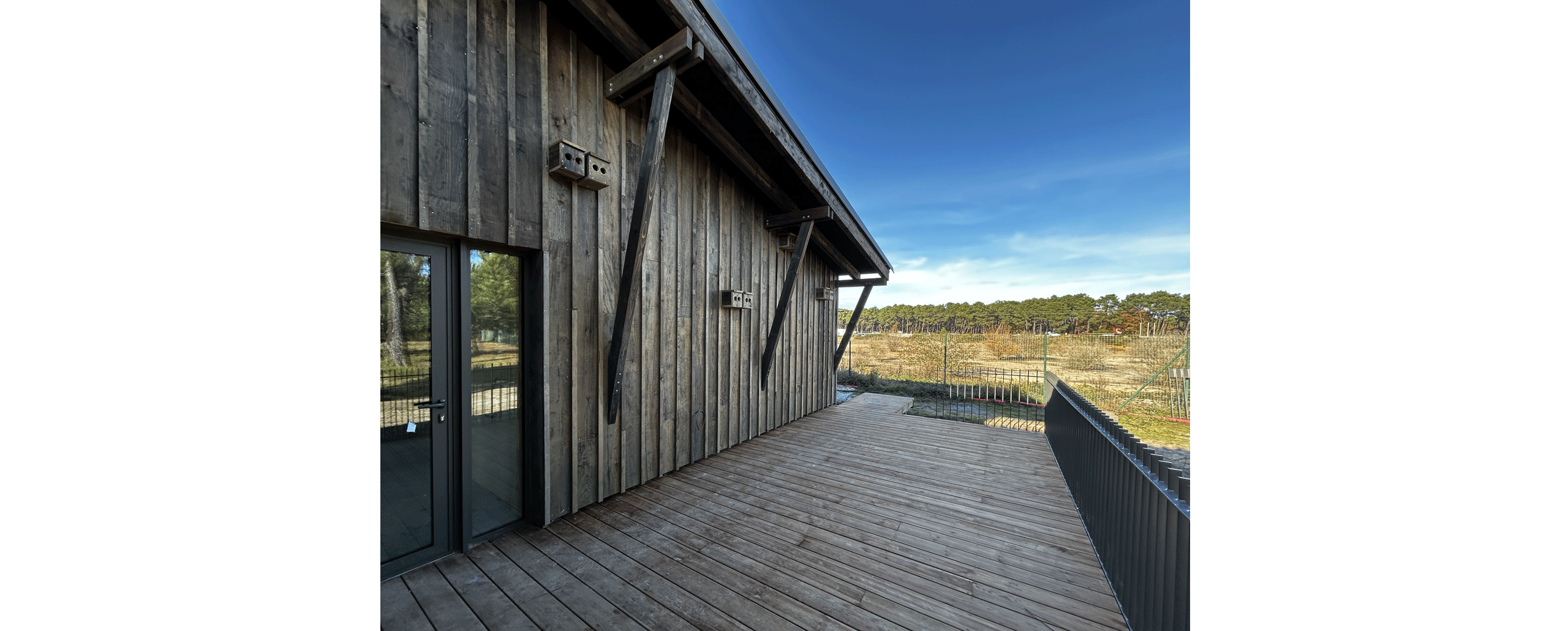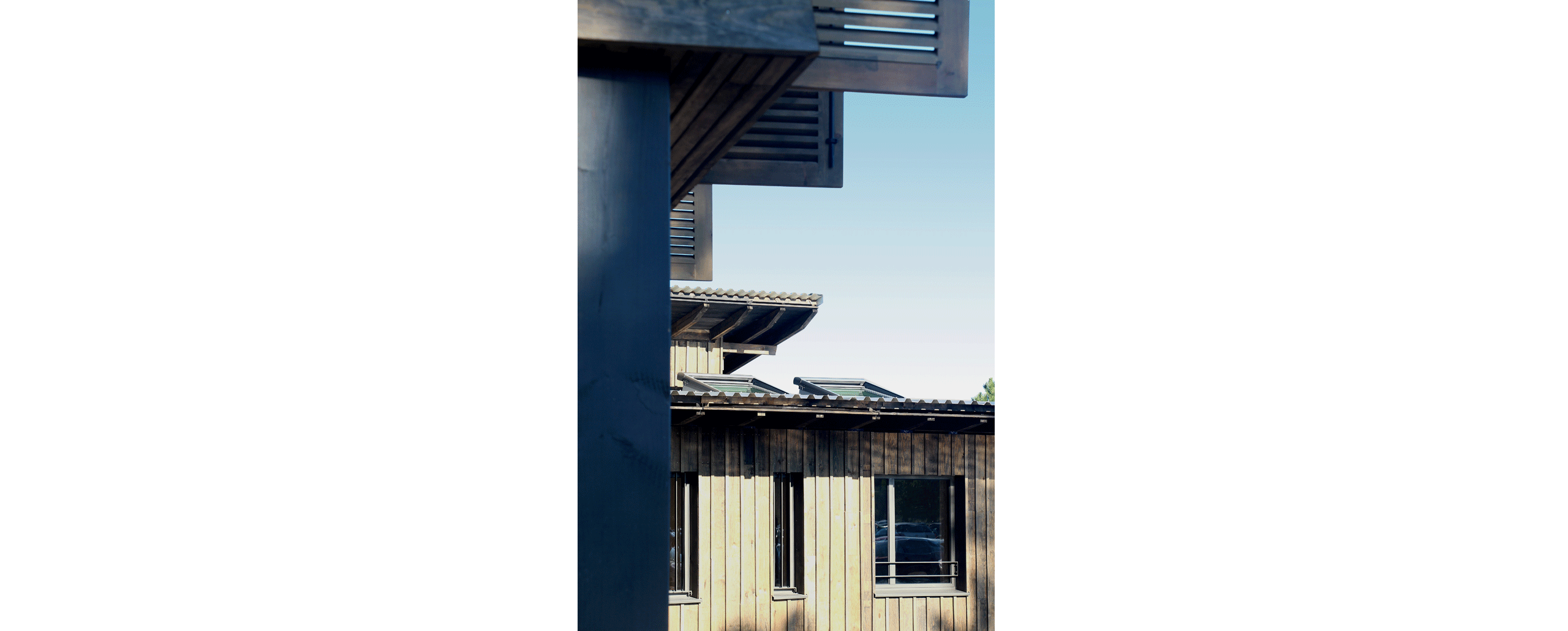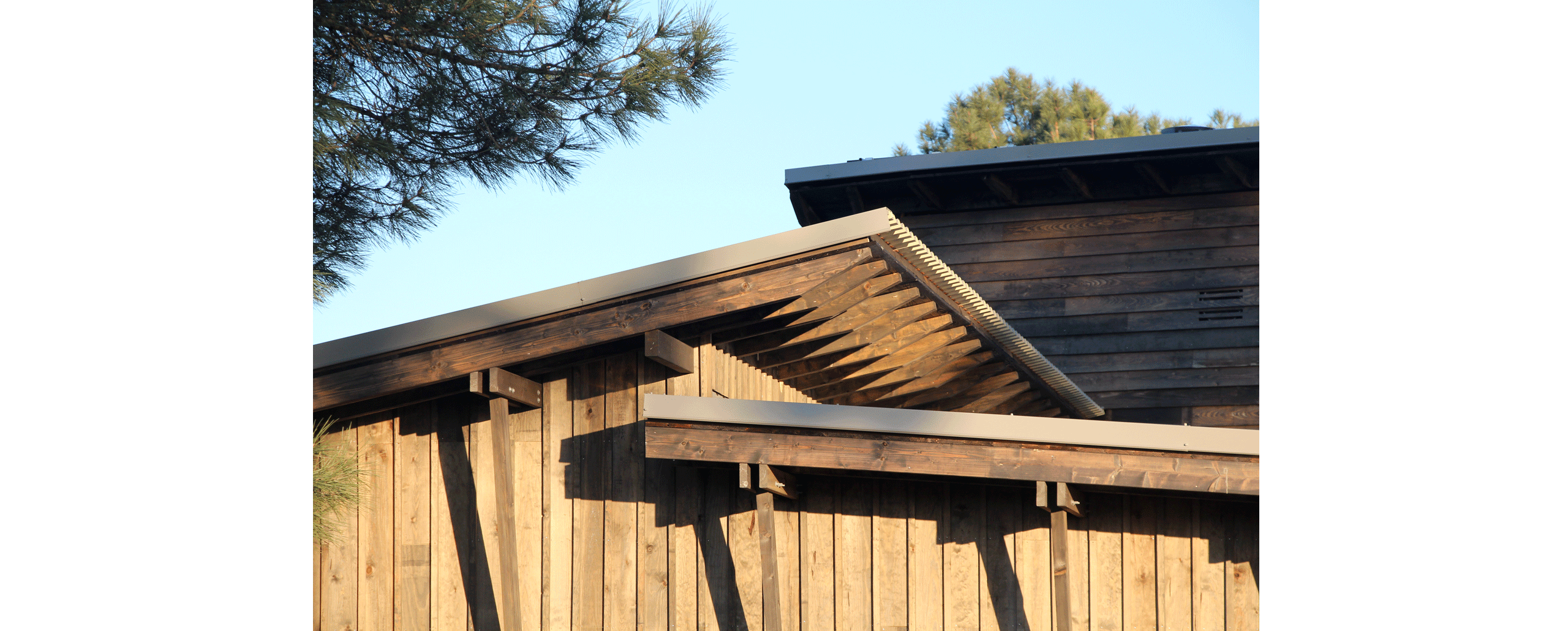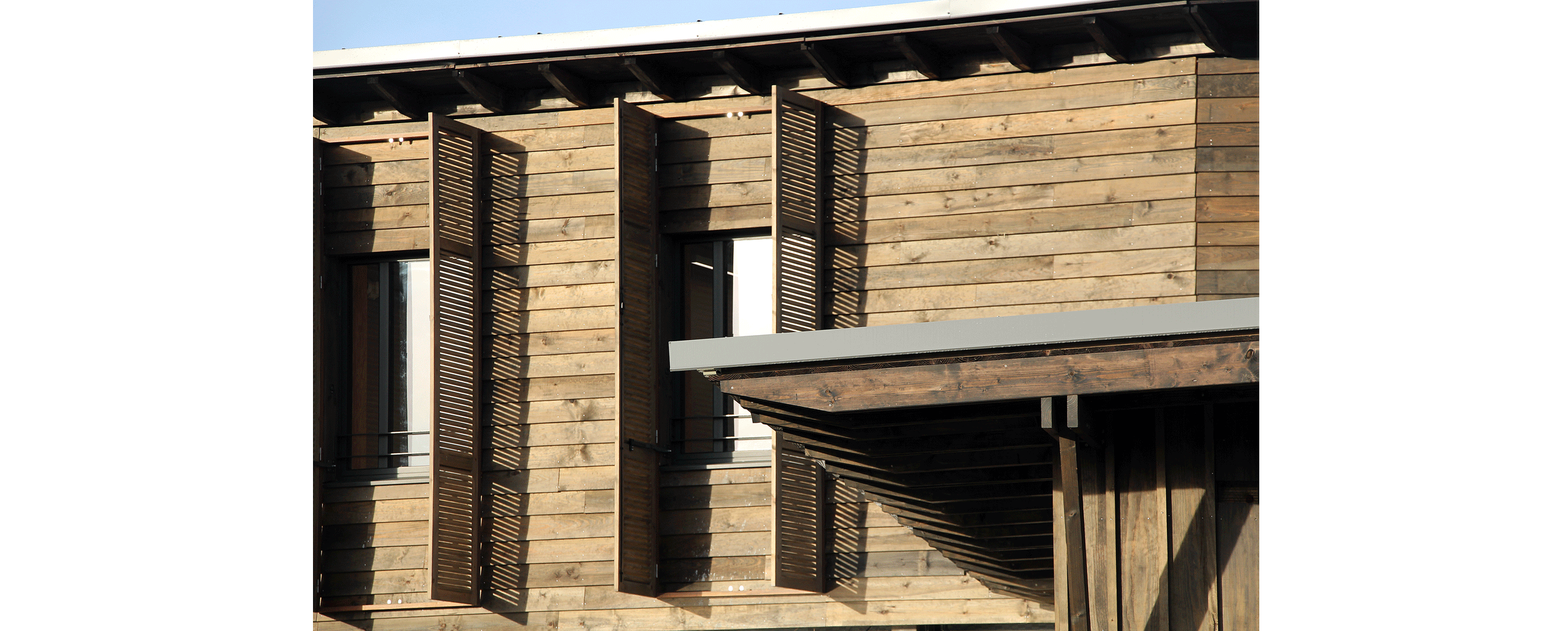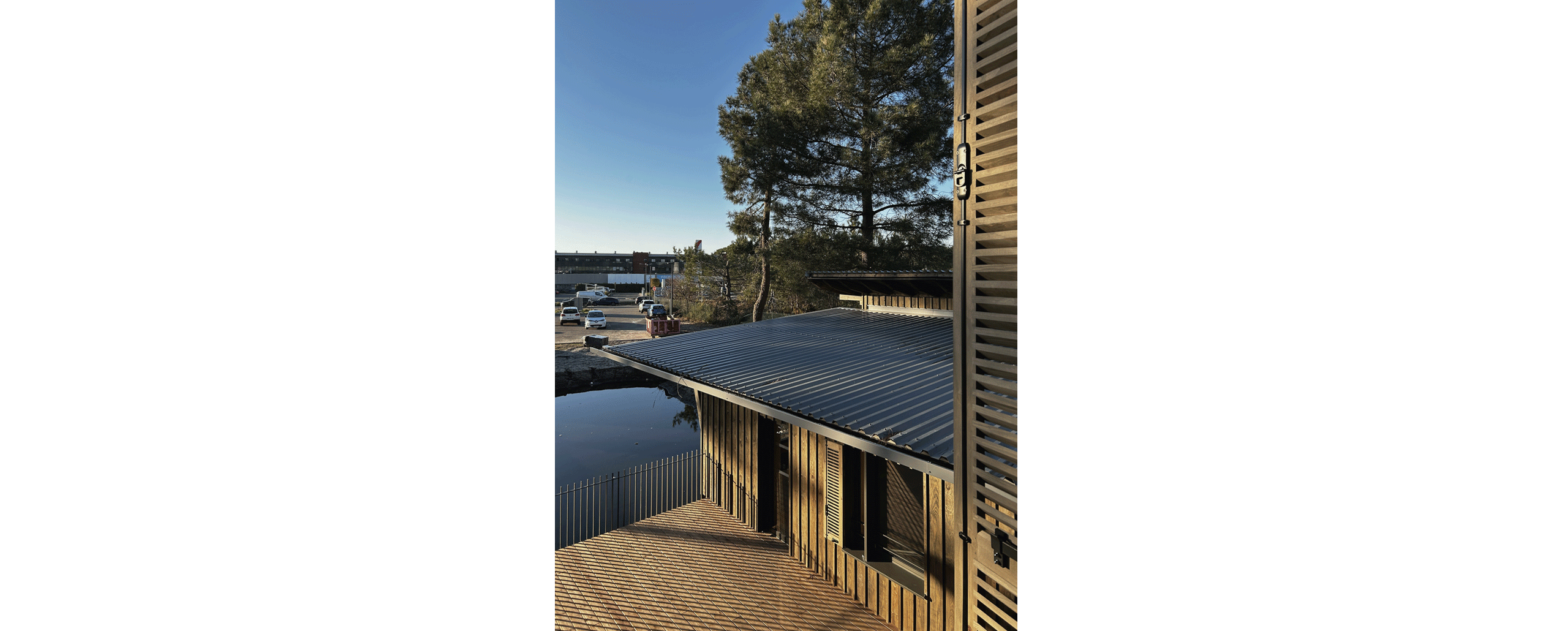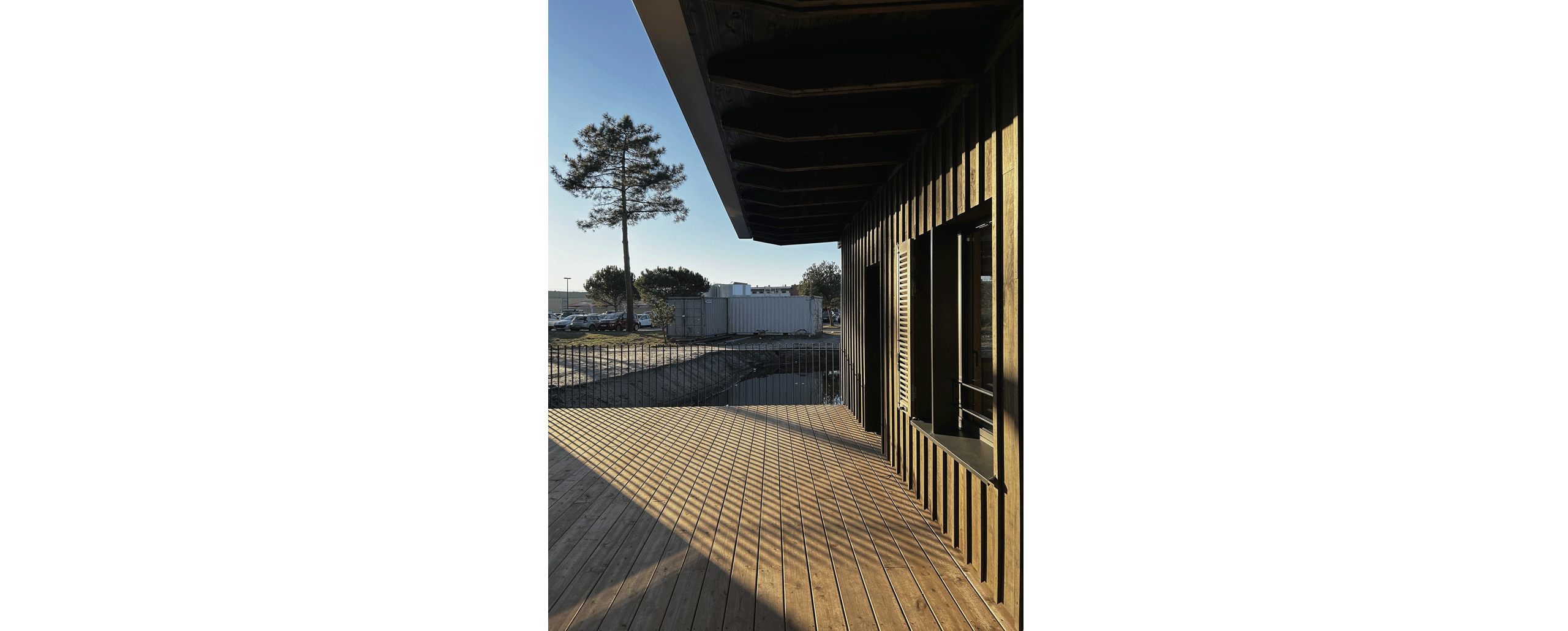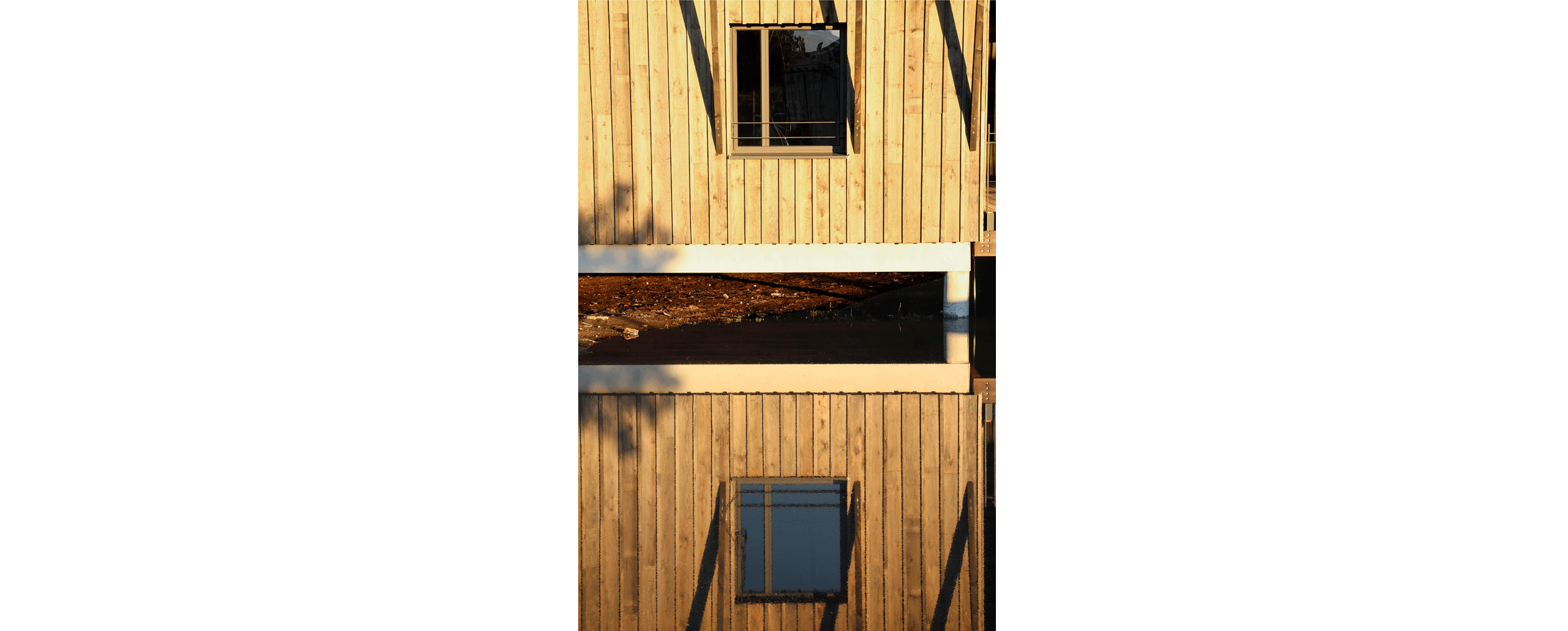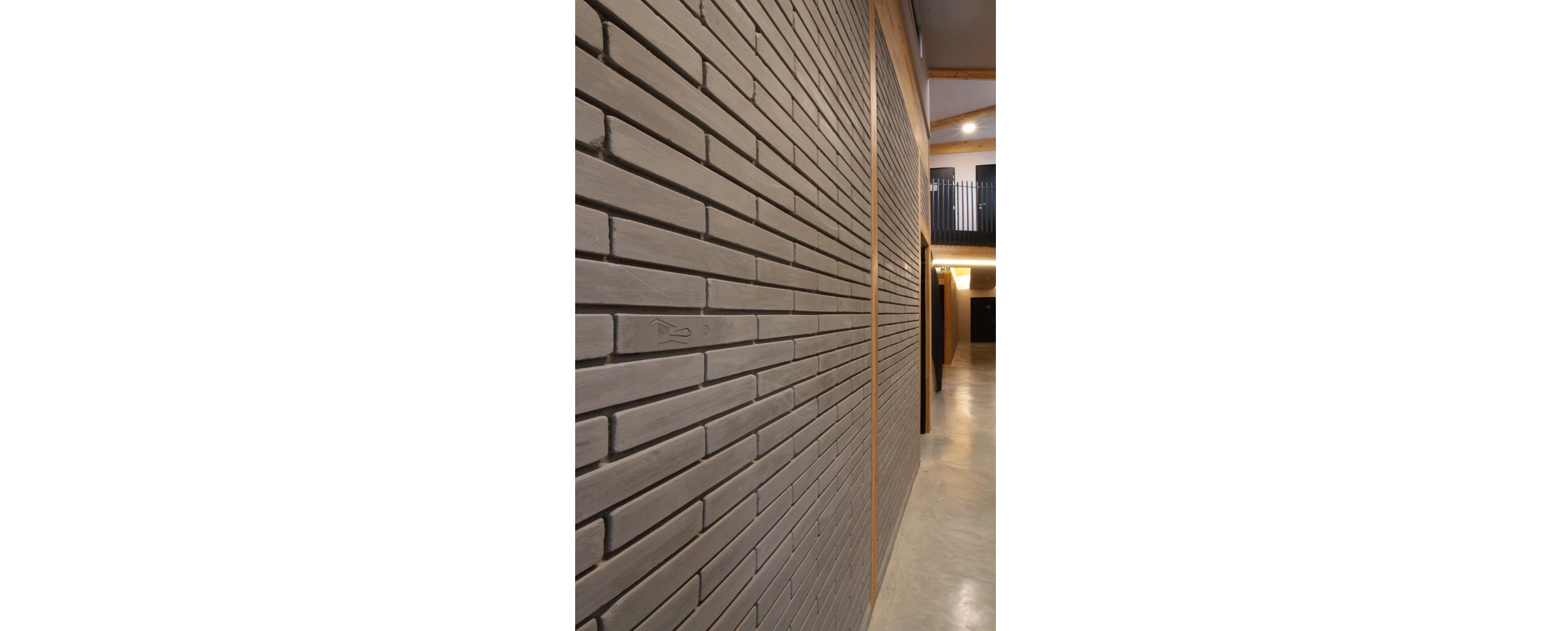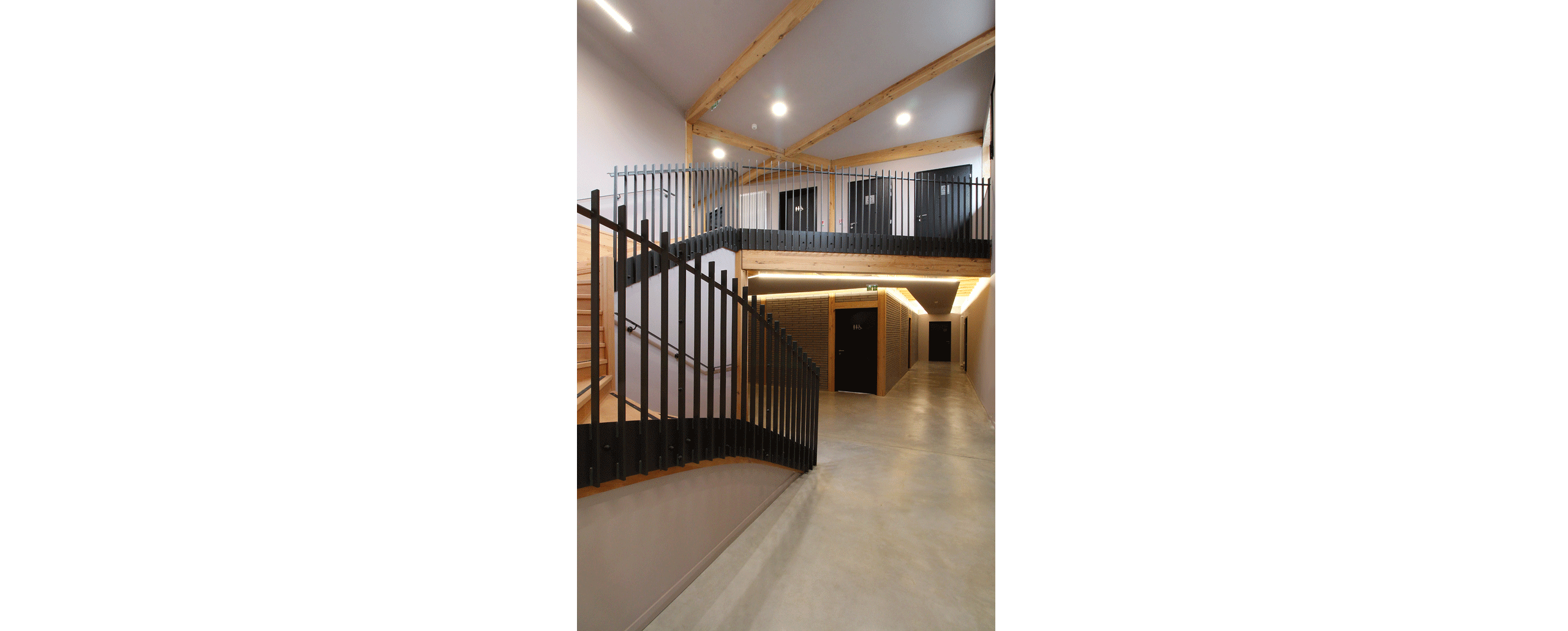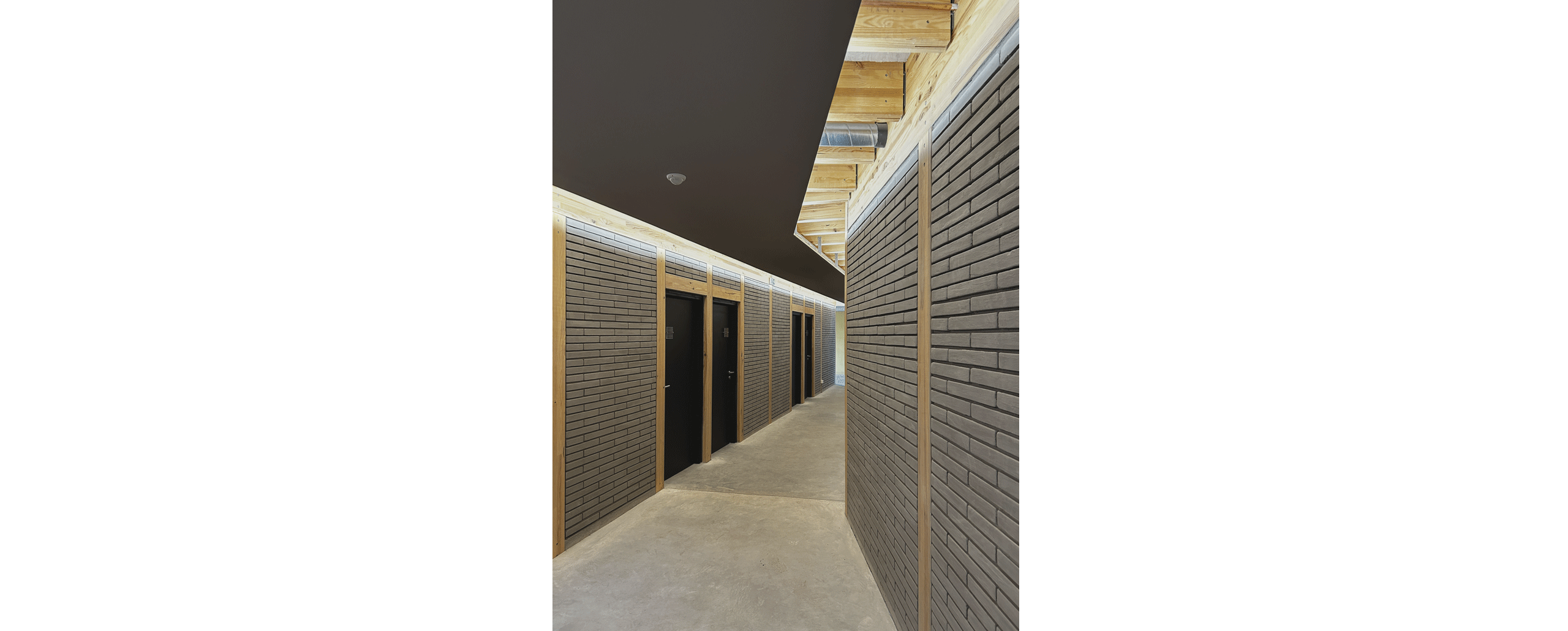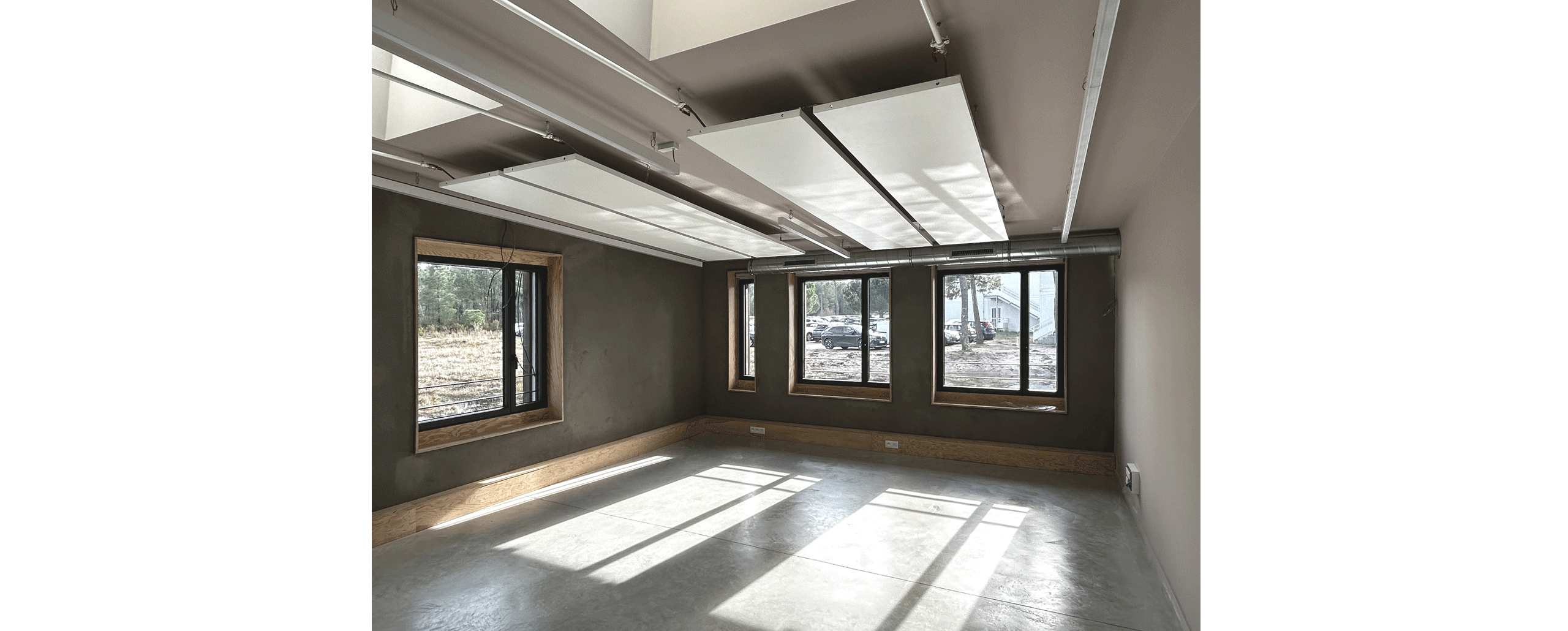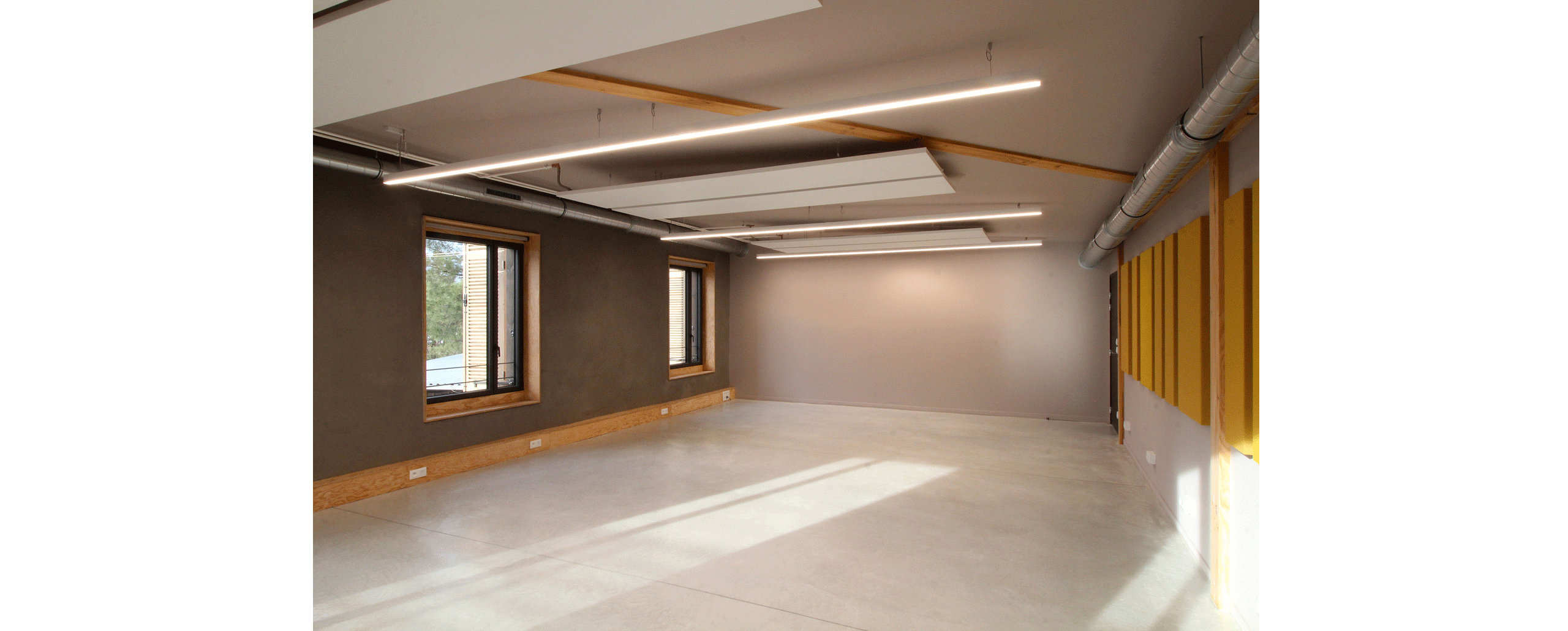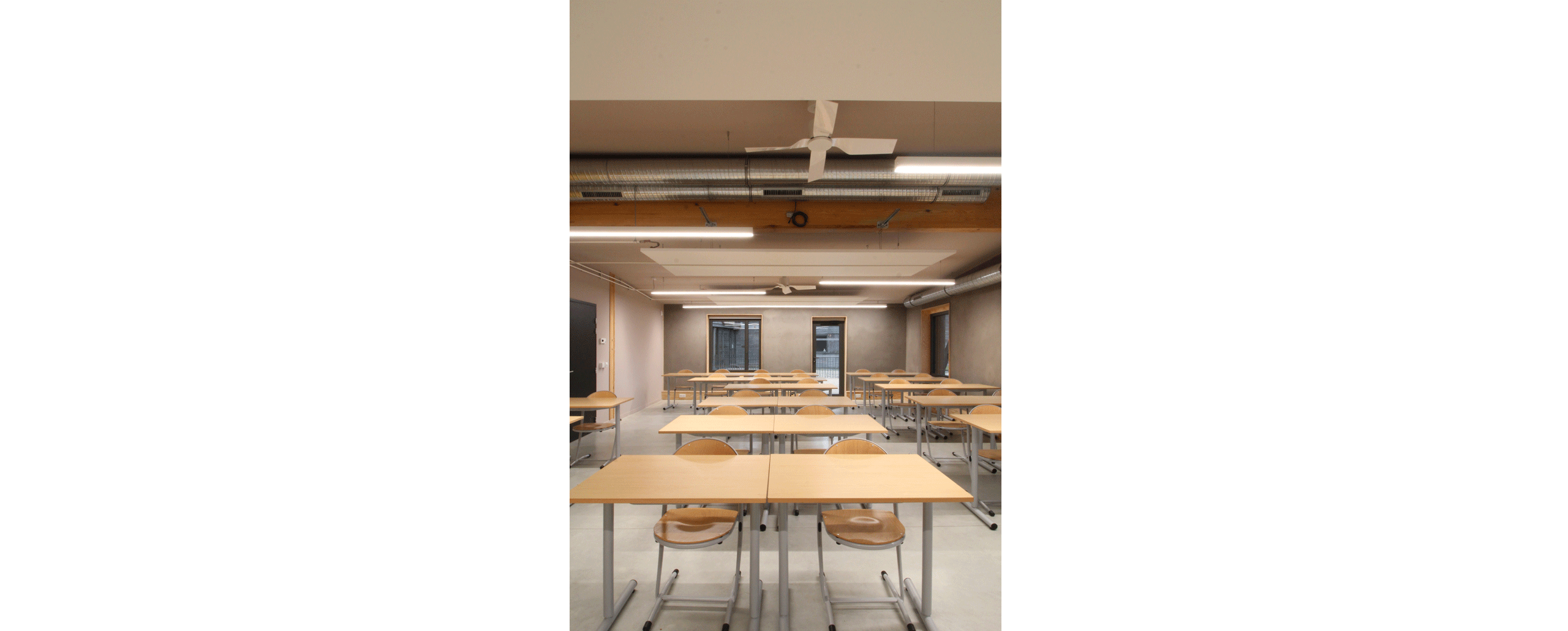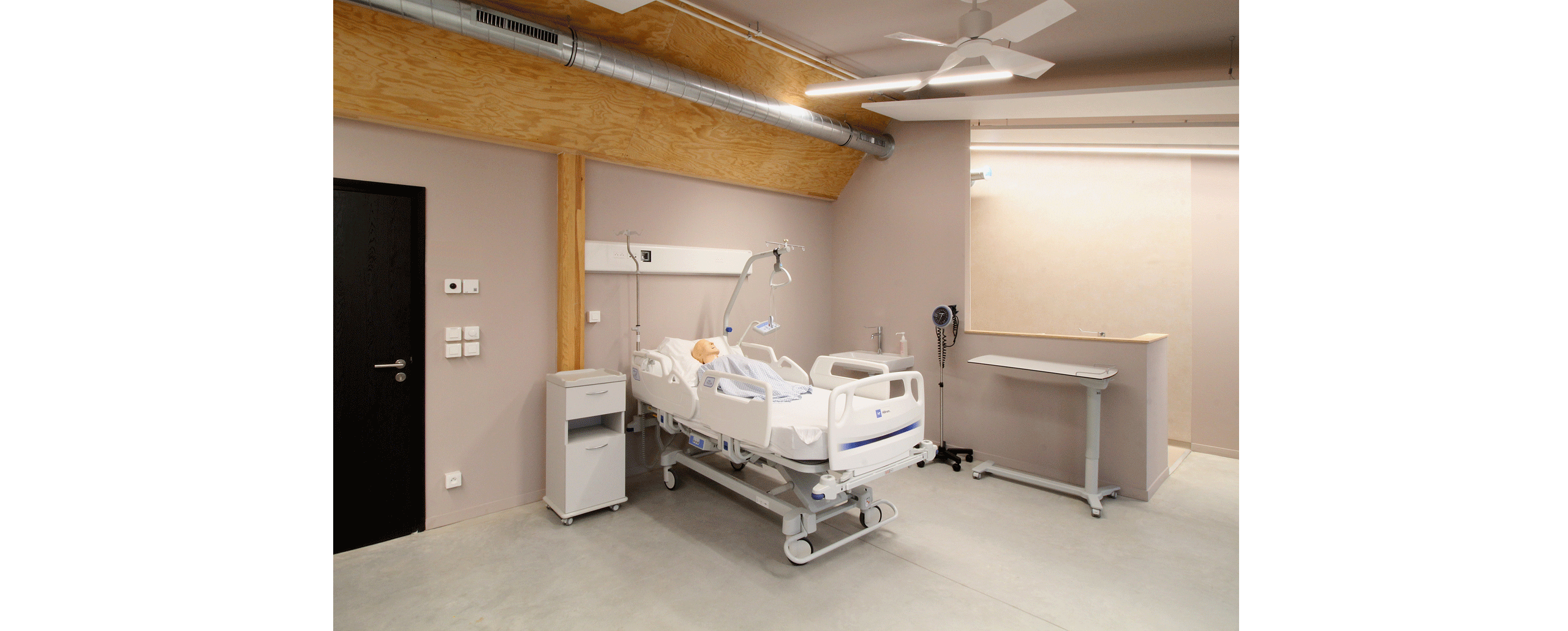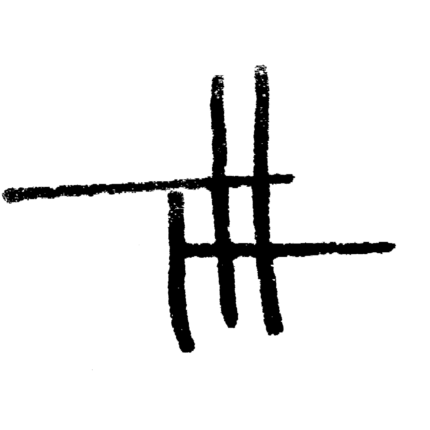
FICHE TECHNIQUE
MAITRE D’OUVRAGE
GCS Pôle de Santé d’Arcachon
MAITRISE D’ŒUVRE
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire
180° Ingénierie, BET Environnemental
Intersections, BET Structure
ODETEC, BET Fluides et thermique
ENTREPRISES
Groupement Etchart – Lamecol (VRD – Gros-Oeuvre – Charpente bois-courverture – maçonneries terre – menuiseiries EXT & INT – Plâtrerie – Peinture – Serrurerie)
EVEAA (CVC – PB)
CIMEA (Cfo-Cfa & photovoltaïque)
COUT TRAVAUX
2 425 000 euros HT
SURFACE PROJET
810 m² SU
Primum non nocere / En premier, ne pas nuire
C’est dans cet objectif, tout en répondant aux attendus programmatiques et au budget de l’opération, qu’a été pensé le projet de construction de l’IFSI du CH Arcachon, guidé par les thématiques suivantes :
– La frugalité et le ménagement, en recherchant une optimisation des surfaces programmatiques, une mutualisation des espaces, et une simplicité des mises en œuvre.
– La performance bioclimatique de l’enveloppe, de par sa forme, son orientation, la composition des parois, l’optimisation de l’éclairage naturelle et de sa ventilation naturelle.
– Une recherche permanente de décarbonation des modes constructifs, favorisant les matériaux biosourcés et des circuits courts, considérant les filières bois, terre et paille.
– L’évolutivité potentielle du bâtiment, en anticipant la redéfinition des espaces intérieurs dans l’écriture des façades et la conception des réseaux.
Ménagement des surfaces :
L’objectif de l’opération était de créer en extension de l’IFAS, le bâtiment de l’IFSI. Il ne s’agissait pas de dupliquer l’institut, mais de mettre en commun et de trouver des synergies entre les deux formations. Après analyse du fonctionnement de l’existant, nous avons proposé une autre implantation au maitre d’ouvrage, motivée par la mutualisation des services ou locaux autour d’une entrée commune. Les espaces d’enseignement spécifique se développent de part et d’autre cette zone commune. Cette démarche a alors permis de supprimer des doublons, de réduire les attentes en surfaces, et donc l’emprise du bâtiment.
Cette implantation implique de construire le bâtiment sur la noue d’infiltration des eaux pluviales du site du centre hospitalier. Incongru mais techniquement faisable, l’hypothèse devient envisageable, nous l’avons donc fait. Cette stratégie a permis de ménager le sol, seule la surface du hall d’entrée ayant été imperméabilisée, et la capacité de la noue ayant été augmentée.
Organisation générale et parti pris architectural :
Le projet mis en place pour accueillir l’IFSI est donc un bâtiment sur pilotis enjambant une noue d’infiltration.
Il se greffe sur la façade Nord du bâtiment existant. Le hall traversant met en relation les deux ailes de l’institut.
Le corps du bâtiment de l’IFSI est décalé par rapport au bâtiment existant, signalant la nouvelle entrée du pôle d’enseignement, abrité sous le débord de l’étage.
Associé au hall, au centre de l’institut, sont regroupé les bureaux et la salle détente. Cette localisation permet la fonction d’accueil, la synergie entre les deux entités, rassemblant les espaces d’échanges et de convivialité. Au-delà, se développent les ailes d’enseignement.
Le périmètre du site, les orientations privilégiées, que ce soit pour les vues ou pour la lumière, ainsi que les arbres existants ont guidé la mise en place du projet architectural. L’aile principale du bâtiment s’étire parallèlement à la limite nord, conduisant à une organisation en T de l’établissement. Cette aile accueille l’ensemble des espaces de formation de l’institut : salles de cours, de TD, de TP ainsi que les vestiaires.
Afin de ménager au maximum les arbres du site, nous avons souhaité limiter l’étalement du bâti, en envisageant un étage partiel. Celui-ci complète la volumétrie du projet en reliant le bâtiment existant et l’aile d’enseignement.
Le choix d’un bâtiment sur pilotis, posé sur la noue, s’étirant sur ses berges, renvoie à l’imaginaire des cabanes ostréicoles, des carrelets sur la Garonne et des pontons sur le bord des plans d’eau. Ce sont ces esthétiques qui ont inspirés le dessin des façades. Sur le RdC, un bardage simple inspiré des cabanes ostréicoles habille les façades, tandis qu’à l’étage, le bardage est cette fois horizontal, reprenant le sens de pose du bâtiment existant. Avec pour nuance une pose en clin à recouvrement, cette pose offre une accroche de la lumière plus importante, faisant écho à celle des tasseaux verticaux du bardage arcachonnais du RdC.
Conception bioclimatique de l’enveloppe :
L’énergie la moins chère étant celle que l’on ne consomme pas, l’un des enjeux majeurs de l’opération a été d’optimiser la qualité bioclimatique du bâtiment pour s’assurer la réalisation d’un projet peu énergivore, tout en offrant un confort d’usage optimal. Tous les éléments passifs permettant la réduction des déperditions et la récupération de chaleur ont été envisagés. Ces dispositifs façonnent l’écriture architecturale, à commencer par la volumétrie, sa compacité, son orientation, la répartition des vitrages, leurs protections, ainsi que la qualité des parois.
L’aile d’enseignement s’étire le long de la noue pour développer une façade sud. Protégées de débord de toiture, les fenêtres sont préservées du rayonnement solaire estival, tout en captant les calories des rayons rasant en hiver. Les façades Est et Ouest, confrontées aux des rayons rasant en toute saison, sont équipées brise-soleils orientables ou de persiennes. Les châssis vitrés sont répartis de manière homogène afin d’offrir de la lumière naturelle dans chacun des espaces, et ainsi limiter le recours à l’éclairage artificiel.
Les consommations d’énergie étant étroitement liées à la qualité de l’enveloppe, nous l’avons souhaité performante, et supérieure aux exigences de la RE2020. Avec un R de 7,1, et surtout un déphasage de 13h, en façade comme en toiture, le projet offre en plus du confort d’hiver, des dispositions passives pour le confort d’été, présservant l’intérieur des chaleurs estivales.
Cette carapace est complétée par une répartition des ouvrants pour une ventilation transversale des espaces qui, activé le soir, permet d’assurer une décharge nocturne lors des périodes de fortes chaleurs.
En complément, nous avons également recherché une forte inertie associée aux espaces intérieurs. Le projet intègre des ouvrages en terre, en brique et en enduit, ainsi que des sols en béton quartzé. Ces ouvrages contribuent à réguler les variations de température lors de l’exploitation du bâtiment, et donc à limiter les surchauffes lors des périodes chaudes. Les enduits terre en finition intérieure assurent en plus la perspirance de l’enveloppe, l’isolement au feu de la paille, tout en participant au confort acoustique.
Enfin, des brasseurs d’air ont été mis en place dans les espaces d’enseignement. Un dispositif permettant d’améliorer encore une peu plus le confort ressenti des usagers avec de très faibles consommations.
La conjugaison de toutes ces dispositions permet au bâtiment de l’IFSI de fournir naturellement les niveaux de conforts visés, hiver comme été, dispensant le recours aux systèmes technologiques complexes, polluants et consommateurs d’énergie.
Décarbonation de la construction : matériaux biosourcés et circuits courts
Afin d’être cohérent dans notre démarche environnementale, nous avons eu à cœur de mettre en place l’enveloppe thermique la plus performante, mais également la plus saine possible. C’est pourquoi le cycle de vies des matériaux a fortement influencé le choix des dispositifs constructifs mis en œuvre. Nous avons privilégié le recours à des produits naturels, renouvelables, et peu transformés dans nos arbitrages. Le projet est donc majoritairement conçu en matériaux biosourcés.
Les façades sont réalisées en mur à ossature bois, isolées en paille, avec un bardage en bois à l’extérieur, et des enduits en terre à l’intérieur. Les toitures sont également réalisées en caissons bois isolées en paille. Les cloisons de la circulation sont quant à elles en briques de terre extrudées. Nous avons également souhaité que les matériaux soient locaux, afin de limiter l’impact du transport et pour privilégier le tissu économique local. Le bois mis en œuvre pour la structure comme pour les bardages est du pin maritime extrais des massifs forestiers des Landes. La paille provient du Lot, un département voisin. La terre des briques et des enduits provient d’un gisement du Barp à moins de 50 km. Les peintures sont des gammes biosourcés d’un fabriquant de peinture de Gironde. Même les panneaux acoustiques sont issus d’une usine de Gradignan, également située à moins de 50 km.
Energie
Nos réflexions sur le volet énergétique ont été animées par les mêmes ambitions, répondre aux besoins en priorisant le bon sens, l’ingéniosité et la simplicité d’usage.
Pour le chauffage, le centre hospitalier possède une chaudière biomasse. Le projet bénéficie de cette production en se raccordant sur le réseau d’eau chaude. Afin de répondre au mieux à l’usage des locaux, deux types de terminaux ont été envisagés. Dans les locaux utilisés en permanence, des radiateurs classiques ont été installés. Dans les espaces des salles de classe, dont l’occupation fluctue en fonction des emplois du temps et des périodes de stage, des panneaux à eau rayonnant ont été installés, offrant une très grande réactivité de chauffe par rayonnement assurant le confort thermique des élèves tout en limitant les consommations.
La même réflexion a été portée pour la ventilation, en envisageant des CTA par zone d’enseignement. Cela permet de moduler la puissance de la ventilation en fonction de l’occupation, et ainsi limiter les consommations au plus juste.
Pour l’électricité, une centrale photovoltaïque a été installée sur la toiture de l’étage, couvrant les besoins de l’institut.
Evolutivité du bâtiment
Les usages peuvent évoluer dans le temps et la destination des locaux également. Cette dimension faisait partie de notre lettre de mission, le maitre d’ouvrage souhaitant que nous anticipions dans notre conception l’évolution potentielle du bâtiment et sa reconversion à moyen ou long terme, sans que cela n’engendre d’importants travaux. Les espaces du projet ont été pensé en ce sens. Ainsi, l’écriture des façades, le dimensionnement et le positionnement des fenêtres, le passage des réseaux dans des coffres démontables en plinthes, la répartition des corps de chauffe, des circuits des commandes d’éclairage, le système de traitement d’air, ont été réfléchis par modules indépendants, permettant d’envisager de recloisonner facilement les espaces en bureaux.
Biodiversité
Bien que notre démarche durant toutes les phases de conception du projet de l’IFSI ait été motivée par le ménagement des sols et des ressources, par la valorisation de matériaux vertueux et biosourcés, l’acte de bâtir n’est pas sans incidence. En construisant, nous avons nécessairement impacté le site existant, et perturbé un écosystème.
Par respect pour son environnement, nous avons tenu à ce que l’élément perturbateur que nous venions d’ériger puisse offrir un refuge à la biodiversité. Intégrés ou en applique des bardages, sous les débords de toiture, des nichoirs pour les hirondelles, les moineaux et les pipistrelles ont été intégrés au bâti, afin de créer une place pour le vivant.
La maitrise d’ouvrage a été sensible à cette attention qui l’a vraisemblablement inspirée : des ruches ont depuis été installées dans le prolongement de l’aile d’enseignement pour produire son propre miel. De plus, en parallèle de cette opération, le centre hospitalier a pu concrétiser de nombreuses actions comme la mise en place d’une thermo frigo pompe pour assurer la production d’eau chaude sanitaire, ou encore l’obtention de la labellisation employeur pro vélo.
Ce projet apparait comme un facilitateur pour toutes les autres actions environnementales menées et permet de montrer l’implication de l’établissement dans le développement durable.
Depuis la livraison, les professionnels se sont appropriés le projet et sont fiers de travailler dans un établissement ambitieux, précurseur dans la recherche de la performance en sobriété énergétique et la préservation de l’environnement. Il s’agit du premier bâtiment en milieux hospitalier français réalisé en paille et la maitrise d’ouvrage espère que ce projet aura valeur d’exemple pour de nombreuses autres réalisations.